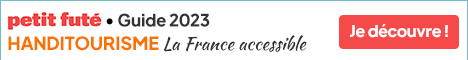Les articles de Caroline LHOMME
Après avoir travaillé une quinzaine d'années dans l'édition, Caroline LHOMME, une rupture d'anévrisme lui a fait découvrir le monde du handicap.Aujourd'hui, elle profite de cette expérience douloureuse mais finalement très riche pour écrire sur des sujets très variés.
Interview de Claudine Hunault, pour l’ouvrage Je me Petit-Suicide au chocolat
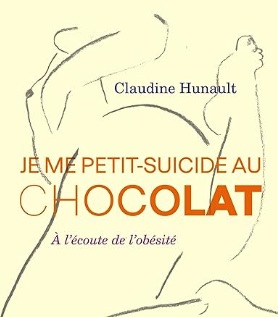
Claudine Hunault est psychanalyste. Pendant 10 ans, invitée par un centre chirurgical de l’obésité, elle s’est mise à l’écoute de patients et en a tiré un très beau texte, recueil de portraits et de réflexions et interrogations sur notre société et son rapport au poids, « je me petit suicide au chocolat ».
1/ Comment vous êtes-vous intéressée au sujet de l’obésité ?
J’ai été sollicitée en 2013 par Roberto Arienzo, chirurgien et responsable du Centre Médico-Chirurgical de l’Obésité à la clinique Paul Picquet à Sens. I
l m’a contactée au double titre du travail psychanalytique et d’une longue expérience du travail corporel. Je développe depuis de nombreuses années des recherches sur la relation au corps, la perception et le rapport à l’espace en tant qu’actrice et en tant que metteur en scène. Les consultations pour les patientes et patients obèses ont été pour moi une expérience inattendue et une rencontre avec un monde à découvrir. Je l’ai d’emblée abordé avec le désir d’élaborer une clinique singulière où le questionnement analytique puisse se tisser avec une réflexion sur la présence à soi et au monde : comment ouvrir une voie à chaque patient, à chaque patiente ? Quelles clés imaginer dont ils et elles puissent s’emparer pour s’émanciper de leurs dépendances ? Comment trouver les mots qui provoquent une prise de conscience et qui ne les condamnent pas ? Comment les appeler à sortir de leur enfermement sans les juger et dans un total respect ? Au fil des consultations, il m’est apparu que les personnes obèses manifestaient dans et par leurs corps, et parfois de façon spectaculaire, des question auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés, que nous ayons ou non des problèmes de poids : le rapport au temps et l’angoisse devant le vide quand soudain notre temps n’est plus empli, voire saturé d’activité, l’expérience de la solitude, la peur de l’abandon, du rejet ou de l’exclusion, la demande d’amour et ses excès, le besoin compulsif d’aider autrui y compris quand il ne le demande pas, la répétition de fonctionnements nocifs dont nous voudrions sortir et dont nous résistons à nous défaire.
2/ Pourquoi ce livre ?
Au cours des consultations, je prenais des milliers de notes. Ces notes au fil des 3 000 patientes et patients sont devenues si denses que le livre y était presque en germe. Il m’a semblé inévitable de prendre la parole et de dire cette expérience. J’en éprouvais une responsabilité. Ces gens venaient, parlaient, j’étais témoin de leur souffrance et de leur désir interdit. Une confiance réciproque autorisait à pousser le travail le plus possible. J’ai eu envie de témoigner sans gravité, avec la légèreté et l’intensité de la parole poétique, avec l’humour qui faisait toujours irruption dans les consultations. Comme un contrat tacite passé avec les patientes et les patients et que je venais honorer. L’écriture a eu une fonction de tiers entre les patients et moi. Elle me permettait d’entendre les tragédies évoquées ou racontées, les souffrances inhérentes à l’obésité et d’en ouvrir en permanence le champ pour en comprendre les multiples ramifications dans la vie du patient ou de la patiente. L’acte d’écriture est un puissant antidote à l’enlisement dans l’affect, or c’est bien de cela qu’il s’agit dans la clinique : appeler la personne à s’extraire de l’emprise affective de ce qui a été vécu.
3/ Comment les personnes obèses peuvent-elles se sortir de cette spirale ?
Nous devons d’abord accepter que nous avons un corps et que nous devrons nous en occuper jusqu’à notre mort, la plus lointaine possible Un corps doit être nourri. Nous pouvons nous passer de beaucoup de choses mais pas de nourriture. Manger est un acte indispensable à la vie. Il s’agit de retrouver avec la nourriture une relation de nécessité et de plaisir et non plus de dépendance. Manger demande du temps, un peu de temps, et pas les 5 minutes pour engloutir un plat comme le font les personnes obèses qui disent pour la plupart manger très vite. Manger n’est pas une perte de temps, dormir non plus. On sait désormais que le manque de sommeil favorise l’obésité. Ces actes-là font partie de la vie. Ils sont nobles et respectables. Nous avons souvent tendance à voir notre corps comme une machine qui doit toujours être performante, valide, et dont une pièce peut être réparée ou changée si elle est défaillante. Or la façon dont notre corps évolue est inséparable de notre histoire. Reconnaître la singularité de notre corps, c’est aussi reconnaître qui nous sommes et en répondre face à une société dont les impératifs marchands ne cessent de lisser et uniformiser les individus. La question se pose pour toute différence qui devient un handicap parce que la société ne lui offre pas d’espace. Est-ce que le fait d’être aveugle, par exemple, est un défaut ou une qualité particulière de perception ? On ne change pas de corps comme on change de voiture ou d’appartement. Nous l’avons pour toujours et il exige de nous du temps et de l’attention pour le mettre en mouvement, en sentir les contours, lui donner une place que nous réinventons tout au long de notre vie. Nourrir notre corps est une façon de l’aimer.
La dépendance à la nourriture, comme à d’autres substances, se caractérise par une réponse identique à des situations différentes : on a un problème au travail, on ne dit rien, on rentre chez soi, on ouvre le frigo, on se remplit. Ou on se sent seul, on mange. Ou on se sent ignoré ou abandonné par son compagnon ou sa compagne, on mange. Ou on est assailli par des images du passé, on a peur, on se relève la nuit et on avale un paquet de Princes au chocolat ou des frites froides etc. Il y a dans la dépendance une répétition d’un schéma qu’on connaît par cœur, qui pèse, qu’on a envie de laisser tomber et dont on n’arrive pas à se débarrasser. Ou plutôt on a envie de s’en sortir et on n’arrive pas à le vouloir. C’est ce que de nombreux patients et patientes traduisent par des phrases comme « je sais que j’en ai pas envie, je sais que ça va me faire du mal et pourtant je le mange ». Bien sûr on pourrait dire que la personne concernée a toute possibilité d’observer ce qu’elle fait et d’y mettre un terme. On peut imaginer qu’elle se dise : à chaque fois que j’ai un problème ou une anxiété, je mange. Donc j’arrête ça. Situation idéale ! Or ce n’est pas ce qui se produit. Pourquoi ? Il y a une souffrance dans les effets de la dépendance mais il y a aussi une jouissance. Jouissance ici ne signifie pas plaisir, la différence est très importante. J’utilise le terme de jouissance au sens juridique du terme où par héritage nous pouvons jouir d’un bien et des revenus de ce bien, une maison dont on hérite par exemple à la mort d’un proche. Ce bien nous appartient, on en fait usage comme bon nous semble.
Les patients et patientes obèses connaissent par cœur le schéma qui les conduit au frigo, au placard, ou à tel rayon du supermarché. Ce fonctionnement est pénible mais il est familier et il rassure, c’est sans surprise. On sait qu’on va manger quelque chose dont on n’a pas envie et qu’on va se sentir aussitôt coupable de l’avoir englouti et, surtout, très vite pour ne pas le voir passer. C’est insupportable mais c’est moins déroutant que de se décoller du geste machinal qui met ce quelque chose dans la bouche. Il y a de l’inconnu qui fait peur et dont on se dit qu’on n’y arrivera pas. C’est là le travail psychologique qui est à faire et l’accompagnement indispensable aux patients pour qu’ils se risquent à agir en dehors des mécanismes qui les emprisonnent. L’inconnu dont je parle, c’est ce qui surgit quand on perd avec les kg de graisse des choses très précieuses dans lesquelles on se reconnaissait : la place de la « bonne grosse hyperserviable », du « gros qui rassure », de « la grosse tellement sympa et rigolote », les représentations de soi dans la famille, avec les amis ou les collègues. L’enjeu est fort et c’est un changement qui va beaucoup plus loin que le passage d’une taille 50 à un 38. La difficulté est que, souvent, la personne prise dans la spirale ne se voit pas prendre du poids comme, d’ailleurs, elle ne se verra pas en perdre.
L’entourage peut aider à sortir de cette spirale s’il n’est pas complice de la prise de poids et s’il ne cherche pas inconsciemment à maintenir l’autre dans son obésité. Toutes ces petites phrases, « tes rondeurs te vont trop bien », « c’est comme ça que je t’aime » ou pire « je te tiens par tes kilos », enferment la personne dans la certitude que rien ne peut bouger. Une personne obèse n’est pas hors sol, son obésité s’est constituée dans un lien étroit avec le milieu dans lequel elle vit. Aujourd’hui, compte tenu de l’augmentation dangereuse de l’obésité, aggravée par ma longue période de confinement, il est essentiel d’informer dans toutes les couches de la société et d’en parler. Plus la parole sur l’obésité se développera chez le grand public, plus les femmes et les hommes concernés oseront voir et dire où ils en sont sans se sentir accusés et stigmatisés.
Je me petit suicide au chocolat, de Claudine Hunault, Le Nouvel Attila, 19 euros
Suggestions: Voici des contenus traitant les même thèmes
- SOMMAIRE
- Les articles de Caroline
- Interview de Louis de
- Interview de Sébastien Roblain,
- Interview de Véronique Bustreel
- Interview de Christian Grapin,
- Interview de Pierre Lemire,
- Interview de Nicolas Peduzzi
- Interview C.C. La brutalité
- Interview de Claudine Hunault,
- Interview d’Axel Alletru
- Interview de Julien Richard-Thomson
- Interview de Claudine Hunault,
- Interview Julien Grand, Chef
- Interview de Jean Dutoya,
- Interview de Bachir Kerroumi
- Interview de Jennifer Sanvoisin,
- Interview du Pf Azulay
- Interview de Charlotte Fairbank
- Hémiplégique, mille sabords !
- Leah Stavenhagen danse contre
- Interview de Angel Su,
- 2022
- Interview de Clotilde Reboul,
- Artec 3D & HP